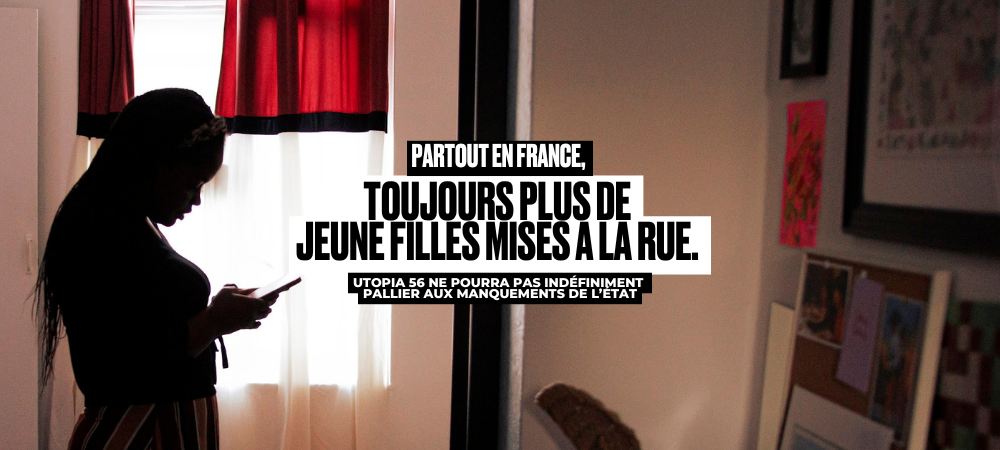En moins d’une semaine, deux jeunes filles de 14 et 16 ans, ont été mises à la rue par le département à Tours, après s’être vues contester leur minorité, et cela, malgré des papiers d’identité prouvant leur âge.
Cette situation est loin d’être isolée. À Paris, nous avons déjà rencontré 24 jeunes filles remises à la rue par la ville depuis le début de l’année, contre 10 en janvier 2024.
Le nombre de jeunes filles abandonnées par les départements, suite à des évaluations sommaires, ne cesse d’augmenter depuis l’année dernière. Les équipes de Lille ont rencontré près du double de jeunes filles mise à la rue en 2024 par rapport à 2023 (26 en 2024, contre 15 en 2023).
Pour la seule ville de Paris, c’est 127 mineures isolées qui ont été rencontrées à la sortie de la cellule d’évaluation l’année dernière, contre 33 en 2023. Ce gros écart pour la capitale s’explique par le fait que jusqu’en juillet 2023, la ville de Paris maintenait l’hébergement inconditionnel pour les filles, et ce, même durant leur recours. Ce n’est plus le cas actuellement.
Ces jeunes mineures non accompagnées arrivent souvent en France après un parcours migratoire lourd et traumatisant. Comme pour les garçons, elles doivent passer une évaluation de la minorité afin d’obtenir le statut de mineure et ainsi être protégées et accompagnées par les dispositifs de la protection de l’enfance. Ces évaluations sont généralement très arbitraires et les décisions se basent sur des raisons subjectives comme “son attitude en entretien” ou “son physique”.
On peut notamment lire sur les papiers de refus :
- “considérant que le document d’identité et/ou le document d’état civil qui pourrait constituer un justificatif de votre minorité semble susceptible de ne pas être conforme”, pour contrecarrer la présentation d’un passeport.
- “considérant que le récit comporte des approximations susceptibles de mettre en cause son authenticité”, lorsqu’on reproche à la jeune ses hésitations qui prouveraient qu’elle invente. Tout comme l’argument inverse existe aussi, si le récit est très détaillé, trop précis, la jeune peut être accusée de l’avoir appris par cœur.
- “considérant que le physique est en décalage avec l’âge déclaré”, alors même qu’il est bien demandé aux évaluateurs de ne pas se fier qu’au physique des jeunes.
Beaucoup ne sont alors pas administrativement reconnues mineures et sont remises dehors, leur vulnérabilité est mise de côté et n’est pas considérée. À la suite de cette évaluation, les départements se dédouanent de toutes responsabilités, alors même qu’ils mettent en péril ces jeunes filles, en les laissant en proie aux dangers de la rue.
La semaine dernière, Carla*, 16 ans, était remise à la rue par la ville de Paris alors même que sa vulnérabilité psychologique et ses pensées suicidaires étaient connues des équipes d’évaluation. Ils ont estimé qu’elle n’était pas mineure et l’ont donc laissé dehors avec un seul document : l’adresse des urgences psychiatriques. C’est quatre jours plus tard, après plusieurs de nos alertes, que la mairie de Paris a répondu et lui a trouvé une place en urgence pour la sortir de la rue. Durant le weekend, Carla* nous a envoyé plusieurs messages inquiétants et a disparu pendant plusieurs heures.
Du fait de leurs multiples statuts – fille, enfant, en situation d’exil – les jeunes filles isolées se heurtent à beaucoup plus de risques. Les mettre à l’abri est une priorité pour leur éviter de passer même une seule nuit dehors. En plus des dangers liés à la rue, il y a le risque des réseaux de traite d’êtres humains ou de prostitution, il suffit de quelques heures dehors pour perdre tout contact.
Parfois ça ne suffit pas. À Rennes, Hawa*, 16 ans, a été mise à la rue par le département jeudi 23 janvier. Elle a pu être accueillie par une hébergeuse de notre réseau solidaire le soir même, mais elle a disparu le lendemain dans la journée. Malgré nos différentes alertes, nous n’avons pas de nouvelles à ce jour. Ce n’est malheureusement pas la première jeune que nous suivons qui disparait ainsi.
Les jeunes mineur⸱es, filles ou garçons, peuvent contester la décision du département en saisissant le juge des enfants, mais le recours dure des mois et en attendant, aucune solution d’hébergement ne leur est proposée. Pourtant, environ 75% des jeunes filles que nous avons accompagnées dans leur recours, ont finalement été reconnues mineures et ont réintégré les services de protection de l’enfance.
Si pour l’instant, nous arrivons encore à trouver des solutions pour leur proposer un toit à toutes, grâce à nos réseaux d’hébergeur⸱euses solidaires, nous allons manquer de ressources et de solutions.
À nouveau, les associations et citoyen⸱nes solidaires pallient les manquements des départements et de l’État dans le système d’accueil, mais jusqu’à quand.
*les prénoms ont été changés.